Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Héritage :
Cette fonction est obsolète et sera supprimée dans une version future :
Reportez-vous aux rubriques Analyse de distance et Migrer des outils de distance existants vers les outils de distance sans distorsion pour plus d’informations sur les fonctionnalités améliorées.
Les outils de distance de chemin, à savoir Distance de chemin, Allocation de distance de chemin et Antécédence de distance de chemin, permettent d’analyser la distance. Combinés aux outils d’analyse hydrologique, euclidienne, de coûts et à d’autres outils Spatial Analyst, ils permettent de modéliser efficacement de nombreux processus de dispersion et de mouvement. Les sections suivantes décrivent la théorie de base sur laquelle reposent les outils de distance de chemin ainsi que la façon d’utiliser ces derniers.
Les règles de base relatives au mouvement qui sous-tendent la distance de chemin
Les outils de distance de chemin sont similaires aux outils de distance de coût dans la mesure où les deux déterminent le coût de déplacement cumulé minimal entre une source et chacune des localisations de cellule sur un raster. Toutefois, la distance de chemin calcule non seulement le coût cumulé par rapport à une surface de coût, mais il le fait tout en prenant en compte la distance de surface réelle qui doit être parcourue ainsi que les facteurs horizontaux et verticaux qui influencent le coût total du déplacement d’un endroit à un autre. La surface de coût cumulé calculée par ces outils peut servir à modéliser la dispersion, le mouvement des flux et l’analyse du chemin de moindre coût.
Pour tirer le meilleur parti des outils de distance de chemin, vous devez comprendre certains principes de base sur la dispersion et le mouvement sur une surface. Pour les illustrer, nous allons étudier la quantité d’énergie, ou pour être plus clair, la quantité de carburant nécessaire pour rallier deux points en voiture en tenant compte de différents facteurs de coût.
Pour parcourir en voiture 80 kilomètres entre un point A et un point B sur une route plate, il faut x litres de carburant.

Il faudra plus de carburant pour parcourir cette même distance avec la même voiture si la surface est accidentée ou irrégulière, par exemple sur une route non bitumée. La quantité de carburant utilisée dans le second cas se calcule en divisant la distance parcourue par le frottement pour obtenir le facteur de frottement (F) qui va compenser les irrégularités de la surface, puis en multipliant ce facteur par la distance à parcourir divisée par le nombre de kilomètres que la voiture peut parcourir avec un litre de carburant sur des surfaces plates et lisses (D = Kilomètres parcourus / Kilomètres par litre). Cela donne la formule suivante :
F x D = carburant_consommé
La formule ci-dessus peut également être appliquée au premier exemple, mais le facteur de frottement est alors bien plus faible que dans le second, où la voiture roule sur une surface lisse.
Si l’itinéraire reliant le point A au point B monte, la voiture doit parcourir plus de distance réelle que si l’itinéraire était plat. (Ignorons pour le moment le fait qu’il faudrait plus de carburant pour propulser la voiture en haut de la pente). La distance qui est alors parcourue est désignée sous le nom de distance de surface (DS).

La distance de surface correspond à la distance réelle à parcourir augmentée en fonction du type de surface. Reprenons l’exemple précédent. La voiture doit maintenant parcourir la surface accidentée sur une plus longue distance. La distance de surface (DS) augmente le coût total du trajet en appliquant un facteur, et non par simple addition. Si on prend en compte la distance de surface (DS remplace D), la formule suivante est utilisée :
F x DS = carburant_consomméLes facteurs horizontaux constituent un autre groupe d’éléments susceptibles d’influencer la consommation d’énergie. Ces facteurs prennent en compte l’itinéraire horizontal le plus facile à parcourir et la distance à laquelle se trouve le point de départ de la voiture. Dans cet exemple, la vitesse du vent peut être un facteur horizontal. Si un vent fort souffle à l’arrière de la voiture, celle-ci consomme moins de carburant pour aller du point A au point B, quelles que soient la surface et la distance réelle du trajet.

Si on inclut le facteur horizontal (FH) dans le coût total du trajet, on obtient la formule suivante :
F DS x FH = carburant_consomméLe facteur horizontal (la vitesse du vent) doit être ajusté pour compenser le frottement horizontal qui va être subi du fait de la relation entre direction du trajet et sens du vent. Par exemple, si le vent souffle dans le dos de la voiture avec un angle de 45 degrés, il lui procure un certain avantage, mais pas autant que s’il soufflait directement derrière elle (angle de 0 degré).

Si la voiture avance directement face au vent, le facteur horizontal de frottement est plus élevé.
Enfin, un dernier facteur va avoir une influence sur la consommation d’énergie de la voiture : la pente, vers le haut ou vers le bas, appelée facteur vertical, que va emprunter la voiture sur le trajet. Dans cet exemple, si la voiture descend une pente, le coût total du trajet diminue ; si elle en gravit une, le coût total du trajet augmente.

Si on incorpore le facteur vertical (FV) à la formule précédente, on obtient la suivante :
F DS x FH x FV = carburant_consomméPour modéliser une source de dispersion ou déplacer un objet, un outil de distance de chemin permet de contrôler le frottement, la distance de surface, le facteur horizontal et le facteur vertical. L’exemple exposé ci-dessus est simple, mais on pourrait illustrer de nombreux éléments ayant un impact sur le mouvement. La plupart des mouvements ne se résument pas à un simple de trajet en voiture sur une surface. Pour certains types de phénomènes, un grand angle vertical ou une déviation significative du sens horizontal de déplacement indiqué peut s’avérer être de moindre coût. Dans d’autres situations, traverser une pente nulle peut être coûteux. Pour les facteurs verticaux, une pente peut signifier densités de l’air, niveaux de concentration ou décibels plutôt qu’élévation. Les outils de distance de chemin permettent de contrôler les facteurs qui influencent la dispersion, comme ceux répertoriés ici, et de personnaliser l’analyse afin de répondre aux exigences du phénomène pris en compte.
Sorties de l’analyse de distance de chemin
Les différents types de sorties des outils de distance de chemin sont décrits dans les sections suivantes.
Sortie de la distance de chemin
La sortie principale de l’outil Distance de chemin est le raster de distance de coût total cumulé. Ce raster stocke la distance cumulée de moindre coût pour chaque cellule, en tenant compte de tous les facteurs de coût, qui résulte de la cellule source de moindre coût. La distance de coût reposant sur une allocation itérative, le plus faible coût cumulé pour chaque cellule d’une source est garanti. Les valeurs cumulées sont fondées sur l’unité de coût indiquée sur la surface de coût.
Sortie de direction d’antécédence de distance de chemin
L’outil Antécédence de distance de chemin identifie, pour chaque cellule, celle qui doit être déplacée ou remise dans le flux pour retourner vers la source qu’il est le moins coûteux de rejoindre.
Les valeurs de la plage du raster en sortie vont de 0 à 8. Elles correspondent à des codes qui identifient la direction vers la cellule voisine suivante (la cellule suivante) pour retracer le chemin de plus faible coût cumulé (de la destination à la source de moindre coût). La valeur 0 est attribuée aux cellules de la source, car elles ont déjà atteint le but (la source).
Si le chemin passe par le voisin de droite, la valeur 1 est attribuée à la cellule en sortie. Si le chemin prend la direction en bas à droite, la valeur est 2, s’il se dirige directement vers le sud, la valeur est 3, et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d’une montre, comme illustré dans le diagramme suivant :
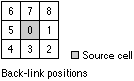
Sortie de l’allocation de distance de chemin
Le raster Allocation de distance de chemin identifie pour chaque cellule la zone de la source qui peut atteindre la localisation de la cellule avec le moindre coût cumulé.
Les valeurs en sortie sont les mêmes que les valeurs de la source en entrée, sauf si des valeurs sont indiquées pour Raster de valeurs en entrée. Dans ce cas, ce sont ces dernières qui sont utilisées.
Sorties facultatives
En plus du raster en sortie spécifique de chaque outil, chacun des outils de distance de chemin peuvent aussi éventuellement créer d’autres types de sorties. L’outil Distance de chemin peut créer un raster d’antécédence et l’outil Antécédence de distance de chemin un raster de distance. L’outil Allocation de distance de chemin peut également de créer à la fois les rasters d’antécédence et de distance. Cela est particulièrement utile si vous souhaitez créer toutes les sorties possibles en n’exécutant qu’un seul outil.
Entrées des outils de distance de chemin
Un jeu de données des localisations des sources est requis comme entrée de tous les outils de distance de chemin. Selon l’outil spécifique et les options utilisées, d’autres entrées peuvent être spécifiées pour mieux contrôler l’analyse.
Entrée source
L’entrée source identifie les localisations depuis lesquelles est calculée la distance de moindre coût cumulé vers chaque cellule autre que source. Il peut s’agir d’un jeu de classes d’entités ou d’un jeu de données raster, le même que vous utiliseriez pour les outils de distance de coût.
Une entrée source peut contenir une seule zone ou plusieurs. Ces zones peuvent ou non être connectées. Les valeurs d’origine affectées aux cellules source sont conservées. Le nombre de cellules source au sein du raster <source> est illimité.
Entrée de coût
Le raster de coût en entrée est également le même que celui que vous utiliseriez dans les outils de distance de coût. Une pondération est attribuée à chaque localisation de cellule. Elle est proportionnelle à un coût relatif encouru par le phénomène qui est modélisé lors de la traversée d’une cellule. En général, les coûts sont fondés sur les entités inhérentes de la localisation qui sont statiques avant le mouvement de l’entité ou du phénomène. Dans la modélisation du mouvement d’un incendie, par exemple, les entités de coût peuvent inclure la pente, l’exposition, l’âge, le type, la teneur en humidité et la couverture végétale.
Les unités de coût sont fondées sur une échelle relative et non sur des unités géographiques. Les unités peuvent être un coût monétaire ou des unités d’énergie dépensées. Les coûts de préférence peuvent ne pas avoir d’unités. L’essentiel est que les valeurs soient sur une échelle relative. Pour le mouvement d’un incendie, l’ajout des valeurs associées à la pente, à l’exposition et au type de végétation va renvoyer des résultats peu significatifs. Toutefois, si chacun de ces attributs est reclassé en fonction de la susceptibilité aux incendies puis ajouté, les résultats générés seront un raster de coût d’incendie.
Les valeurs de coût attribuées à chaque cellule représentent les mesures par unité de distance pour la cellule.
En interprétant les coûts stockés dans chaque cellule comme le coût par unité de distance du passage à travers la cellule, l’analyse devient indépendante de la résolution. Supposons que nous ayons deux rasters, un avec une résolution de 50 mètres, l’autre avec une résolution de 100 mètres. Dans chaque raster, il est attribué cinq unités de coût à plusieurs cellules adjacentes pour traverser chaque cellule. Les cinq unités de coût sont appliquées à chaque unité de distance (ici, le coût du déplacement d’un mètre). Par conséquent, un déplacement de 100 mètres à travers les cellules de l’un ou l’autre des rasters coûtera 500 unités de coût, quelle que soit la résolution.
Exemple
Si la taille de la cellule est exprimée en mètres, le coût attribué à la cellule est le coût requis pour parcourir un mètre dans la cellule. Si la résolution est de 50 mètres, le coût total du déplacement dépendra à alors des éléments suivants :
- Si le déplacement s’effectue de façon perpendiculaire à travers la cellule (horizontalement ou verticalement), le coût total est égal au coût attribué à la cellule multiplié par la résolution (coût_total_perpendiculaire = coût x 50).
- Si le déplacement s’effectue en diagonale à travers la cellule, le coût total est égal au coût attribué à la cellule multiplié par le facteur de diagonale d’environ 1,414214, ou √2, (coût_total_diagonale = 1,414214 x (coût x 50)).
Raster de surface
Un raster de surface en entrée permet de déterminer la distance de surface réelle, et non la distance planimétrique (« en ligne droite »), parcourue d’une cellule à la suivante. Le raster de surface en entrée est généralement l’élévation.
Il convient d’appliquer le théorème de Pythagore pour calculer la distance de déplacement réelle entre la cellule a et la cellule b :

- Si le coût est calculé vers l’un des quatre voisins adjacents, la longueur de la base (a) est égale à la taille de cellule (distance entre le centre d’une cellule et le centre d’une autre).
- Si le coût est déterminé par une cellule diagonale, la base est déduite de la taille de cellule multipliée par environ 1,414214 (ou √2).
Pour déterminer la hauteur (b) du triangle, la hauteur de la cellule de destination sur le raster de surface est soustraite de la hauteur de la cellule de départ.
Si la surface n’est pas plate, la distance parcourue est plus importante. Une distance plus importante implique un coût plus élevé à un taux déterminé par le raster de coût en entrée et par les facteurs horizontaux et verticaux.
Le coût du franchissement de l’angle d’inclinaison vers le haut ou le bas (la pente) ne se calcule pas forcément uniquement à partir du raster de surface. Les coûts associés à l’angle de la pente sont calculés à partir du raster de facteur vertical en entrée et des facteurs de coûts verticaux qui l’accompagnent. Le raster utilisé pour le raster de facteur vertical peut être le même que celui utilisé pour le raster de surface en entrée.
Informations supplémentaires sur les calculs de distance de chemin
Définition d’un seuil de distance maximale
Il arrive qu’un seuil de coût cumulé soit atteint au-delà de ce qui vous intéresse. Ce seuil est contrôlé par le paramètre de distance maximale. Toute localisation qui dépasse le seuil se voit attribuer la valeur NoData dans le raster de distance de coût en sortie.
Utilisation d’autres valeurs dans le raster d’allocation en sortie
Si les valeurs associées aux cellules source du raster source en entrée doivent être remplacées par d’autres valeurs dans le raster d’allocation en sortie, un raster de valeurs peut être utilisée en entrée. Les valeurs définies pour chaque cellule source par le raster de valeurs sont alors attribuées à toutes les cellules allouées à la localisation de cellule source dans le raster d’allocation de coût.
Variations sur les éléments
Il est possible de modéliser de nombreuses variations avec l’outil Distance de chemin, en modifiant un, ou tous les paramètres en entrée. Par exemple, s’il n’y a pas de raster de surface en entrée pour calculer la distance de surface, ni d’éléments de coût de facteur vertical ou horizontal, l’outil Distance de chemin effectue les mêmes calculs que l’outil Distance de coût. Lorsque la distance de coût est calculée sur une surface plate, aucun raster de surface en entrée n’est nécessaire.
Parfois, un des rasters de facteur vertical ou horizontal contient la même valeur pour chaque localisation de cellule. Imaginons que l’on essaie de modéliser le vent dans une situation où la microtopographie ne présente aucun intérêt et où les vents proviennent essentiellement d’une seule direction (sud-est, par exemple). Chaque localisation de cellule sur le raster horizontal peut être définie sur 45 degrés.
Unités des facteurs en entrée
Au moment de déterminer les facteurs de coût, tenez compte des effets suivants :
- Une pente positive ou négative entre des cellules augmente la distance de surface, et donc le coût.
- Un facteur horizontal ou vertical égal à 1 est sans conséquence sur le coût du déplacement entre cellules. En revanche, si le facteur est inférieur à 1, le coût diminue, s’il est supérieur à 1 le coût augmente.
Au moment de déterminer la fonction de facteur horizontal ou vertical à utiliser (notamment si vous les changez avec des modificateurs) ou lorsque vous créez un graphique de facteur personnalisé, pensez aux unités de coût d’origine dans le raster de coût en entrée et aux effets d’un facteur sur ces unités.
Mode de calcul de la distance de chemin
Pour en savoir plus sur la façon dont les sorties des outils de distance de chemin sont calculées, rendez-vous à la section suivante :
Rubriques connexes
Vous avez un commentaire à formuler concernant cette rubrique ?